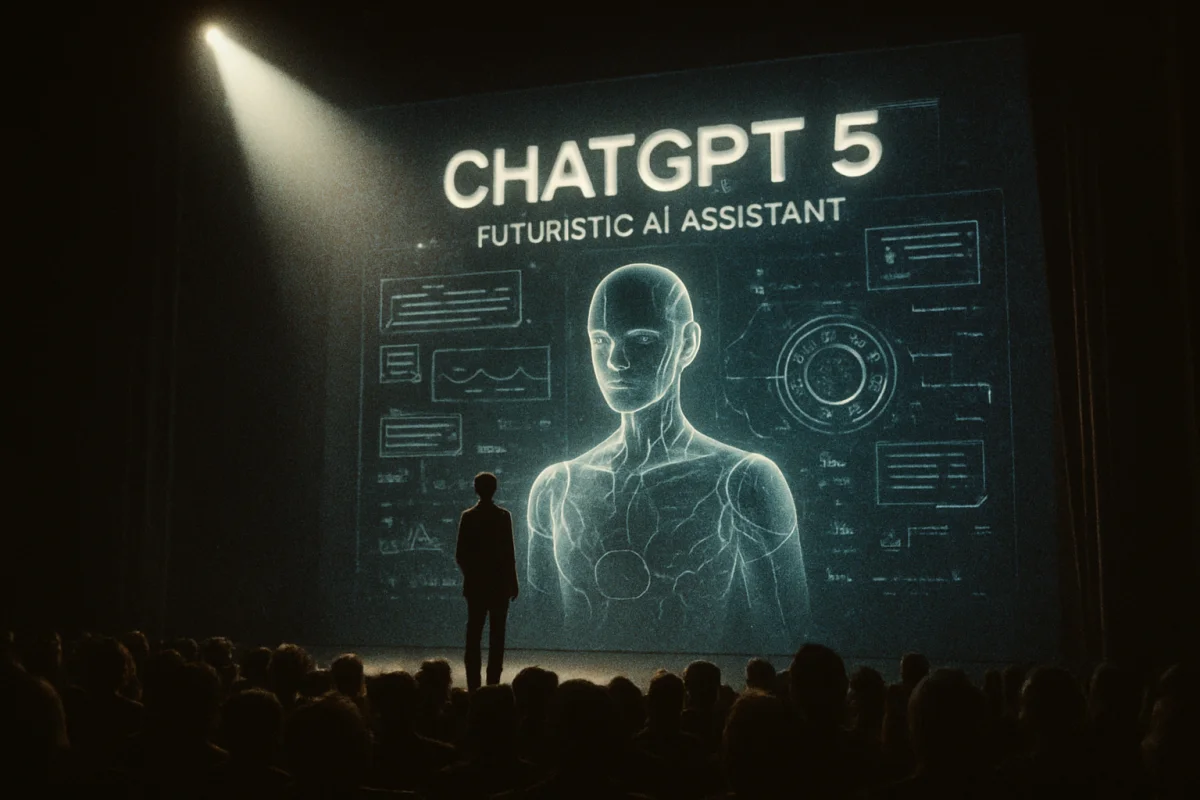Stockage de données sur ADN : Microsoft lance l’archivage génétique pour 10 000 ans
Microsoft et l’Université de Washington ouvrent une nouvelle ère dans l’archivage génétique : le stockage de données sur ADN. Ce projet pionnier mise sur l’activation laser et la technologie biochimique pour proposer une alternative durable aux systèmes traditionnels HDD et SSD — un possible avenir du stockage.

Comment fonctionne ce système ?
La méthode de stockage ADN transforme les fichiers numériques en code ADN synthétique. Microsoft et UW ont conçu un dispositif automatisé qui associe algorithmes, synthèse moléculaire et séquençage. Ils ont déjà réussi à archiver et restituer textes et images : une première boucle complète pour cette technologie.
Pourquoi est-ce révolutionnaire ?
La densité et la durabilité de l’ADN sont remarquables : un gramme d’ADN peut contenir plus d’un zettaoctet de données, restant stable durant des millénaires. Selon les études, vingt grammes d’ADN synthétique suffiraient à remplacer un data center moderne.
Défis techniques
Malgré ce potentiel, la technologie n’est pas encore commercialement rentable : le coût élevé de la synthèse et du séquençage ADN ainsi que la lenteur de l’écriture restent des obstacles. Pourtant, plus de 200 Mo ont déjà été archivés de façon stable. Les experts prévoient une adoption plus large entre 2030 et 2035 à mesure que les coûts diminueront.
Applications et enjeux éthiques
Les usages vont de la préservation du patrimoine culturel à la protection des archives d’État, en passant par la conservation à très long terme. Mais de vraies questions bioéthiques émergent : à qui appartiennent les données sur ADN ? Comment réguler la génétique synthétique ? Quelle sécurité pour ces informations ?
Conclusion
L’archive ADN annonce un futur où l’information est stockée dans la biomolécule la plus compacte et résistante qui soit. Mais son adoption dépendra du coût, de la sécurité et de la confiance du public.
📌 L’humanité pourra-t-elle vraiment archiver ses données pour des millénaires grâce à l’ADN ?
✍ Thornike • 27 juin 2025